
La seconde édition du rapport de l’Union pour la Méditerranée sur l’intégration régionale, publiée l’année marquant le 30e anniversaire du processus de Barcelone, examine l’état de l’interconnexion économique euro-méditerranéenne et fournit des recommandations politiques fondées sur des éléments probants qui promeuvent l’intégration en tant que moteur d’une croissance économique durable et du développement social.
Publiée par l’UpM en collaboration avec l’OCDE et avec le soutien de la Coopération allemande au développement (GIZ), cette évaluation fondée sur des données fiables couvre cinq domaines clés de l’intégration : le commerce, la finance, les infrastructures, la circulation des personnes, ainsi que l’enseignement supérieur et la recherche. Cette évaluation s’appuie sur la première édition, publiée en 2021, et met à jour le cadre analytique avec trois nouvelles dimensions transversales : les questions de genre, la numérisation et la protection de l’environnement.
L’intégration économique dans la région euro-méditerranéenne reste en deçà de son potentiel en raison de difficultés persistantes dans la circulation des biens, des services, des capitaux, des personnes et des idées. Depuis 2021, la région a été exposée à de graves bouleversements, notamment la guerre en Ukraine, qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement et mis à mal la sécurité et les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ainsi que le conflit actuel au Moyen-Orient, lequel fragilise la résilience, l’attrait pour les investisseurs et la croissance socio-économique.
D’autres évolutions ont toutefois contribué à façonner positivement l’intégration, comme l’intensification des échanges avec les pays du Golfe ou les efforts panafricains. Le rapport souligne également l’importance de la connectivité des infrastructures pour faire progresser le commerce, l’investissement, l’innovation, les compétences et la diversification économique, tout en mettant en évidence de nouvelles opportunités pour une intégration plus poussée, telles que la transition verte et l’évolution des modèles de mobilité.
Commerce
Les échanges intra-régionaux de marchandises ont augmenté, dont la tendance évolue vers un commerce à plus forte valeur ajoutée et un renforcement des chaînes de valeur régionales.
Les flux commerciaux dans la région euro-méditerranéenne représentent une part importante de l’économie mondiale, soit un tiers de l’ensemble des exportations mondiales en 2022, pour une valeur de 7,2 milliards de dollars. Alors que la valeur totale des exportations a triplé depuis 1996, sa part au niveau mondial est inférieure à ce qu’elle était au début des années 2000, lorsqu’elle culminait à 40 %. Au sein de la région, l’UE est le partenaire commercial dominant : en 2022, 94 % des exportations intérieures, représentant environ 3,9 billions de dollars, étaient attribuées à l’UE, bien qu’une intégration commerciale accrue entre la Turquie, les Balkans occidentaux et l’Afrique du Nord ait également été observée.
Les mesures non tarifaires telles que les réglementations techniques, les normes, les procédures douanières et les exigences environnementales peuvent avoir un impact profond sur l’accès au marché, les coûts de mise en conformité et les flux commerciaux, créant des obstacles pour les partenaires manquant de capacités technologiques ou financières. L’initiative visant à harmoniser les règles d’origine des produits dans la zone pan-euro-méditerranéenne (PEM) pourrait contribuer à atténuer ce problème. D’autre part, des mesures telles que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (MACF – CBAM en anglais) sont susceptibles d’augmenter les coûts d’exportation et de réduire la compétitivité des économies qui tentent d’accéder au marché de l’UE.
Le développement industriel de la région a suivi des trajectoires variées, mais on observe dans l’ensemble une forte croissance des exportations de machines, de produits chimiques et d’équipements de transport, indiquant une évolution vers des industries plus avancées et des activités à plus forte valeur ajoutée. D’autres secteurs, tels que le textile, affichent des tendances à la baisse, soulignant l’importance de l’adaptation et de l’innovation afin de rester compétitif sur le marché mondial.
Les importations en provenance de Chine sont passées de 1,9 % en 1996 à 9,2 % en 2022, malgré les vulnérabilités révélées par la pandémie. Les pays du Golfe sont des partenaires énergétiques importants pour la région, les produits manufacturés dans la région UpM étant les premiers à être exportés vers leurs marchés. Cette relation est toutefois marquée par des fluctuations définies par la variation des prix mondiaux des hydrocarbures. Le commerce avec l’Afrique subsaharienne a augmenté entre 1996 et 2015, et bien que cette tendance se soit ralentie depuis, les échanges économiques de l’UpM en 2023 représentent 82 milliards de dollars pour les exportations vers la région et 75 milliards de dollars pour les importations.
Les accords commerciaux portent principalement sur les marchandises, malgré l’importance croissante des services et du commerce numérique : en 2023, le commerce mondial a diminué de 5 %, mais le commerce des services a augmenté de 8 %. Actuellement, seuls les accords entre l’UE et les Balkans occidentaux et un accord bilatéral entre la Turquie et la
Serbie prévoient des dispositions relatives au commerce numérique, alors que ce secteur représente 25 % de l’ensemble des échanges commerciaux.
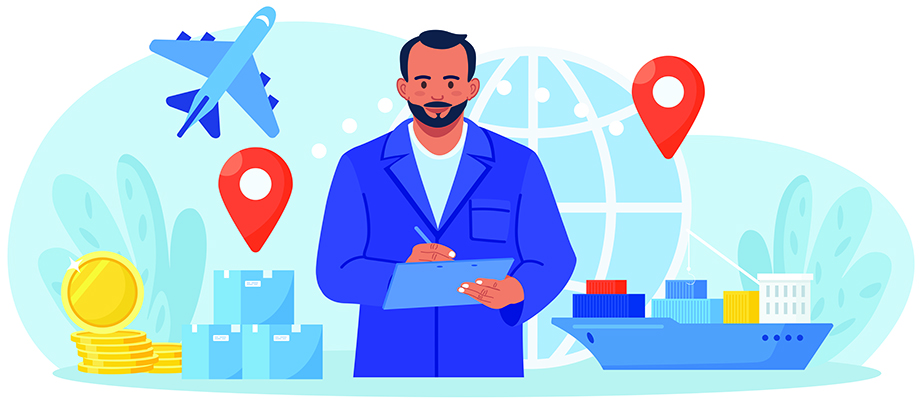
Recommandations politiques :
Développer des accords commerciaux de nouvelle génération qui englobent les services, l'investissement, le commerce numérique et la coopération réglementaire tout en modernisant et en appliquant les accords existants.
Améliorer la facilitation des échanges grâce à une coopération renforcée aux frontières, à la numérisation, à la reconnaissance mutuelle des normes et à une transparence accrue.
Promouvoir la diversification économique vers des activités à plus forte valeur ajoutée et soutenir le développement de chaînes de valeur régionales pour les biens et les services.
Finance
Le développement et l’intégration financiers restent fragmentés, reflétant les disparités économiques, institutionnelles et géographiques.

Bien que les secteurs financiers de la région soient largement hétérogènes en raison de facteurs tels que le PIB par habitant ou la structure et l’ouverture des marchés, une caractéristique commune est la prédominance du financement bancaire. L’accès limité à des sources de financement diversifiées et les contraintes persistantes sont particulièrement évidents dans les régions MENA et Balkans occidentaux.
Les risques géopolitiques complexifient davantage le paysage, en particulier dans les pays de la région MENA, où les coûts élevés des emprunts souverains, les primes de risque et le resserrement des conditions de financement extérieur découragent l’investissement. Dans certains pays, l’accès au crédit pour les entreprises privées reste limité. En Égypte, en Algérie et en Albanie, notamment, le crédit intérieur au secteur privé représente environ 30 % du PIB, soit un niveau bien inférieur à la moyenne de l’UE, qui se situe à 80 %.
Les investissements directs étrangers (IDE) ont globalement bien résisté au cours de la période 2013-2023, avec des différences sous-régionales notables (2,9 % du PIB dans les pays de la région MENA contre 6,1 % dans les Balkans occidentaux). Les principales sources d’IDE dans les Balkans occidentaux sont les pays de l’UE, attirés par la proximité géographique et le coût de la main-d’oeuvre. L’UE est également la première source d’investissement dans les pays de la région MENA, à l’exception notable de l’Égypte. Les économies du Golfe apparaissent comme des investisseurs clés, avec des investissements substantiels au Maroc (11 milliards de dollars), en Algérie (2,2 milliards de dollars) et en Tunisie (1 milliard de dollars) en 2023.
Les transferts de fonds dépassent l’IDE et l’aide publique au développement dans plusieurs économies. En 2023, ils représentaient environ 35 % du PIB au Liban, 20 % en Palestine et 10 % en Jordanie, tandis que dans la plupart des autres pays de la région MENA, ce pourcentage s’élevait à 5 %. De même, en Albanie, au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine, les IDE et l’aide publique au développement ont été supérieurs à 10 % du PIB. En termes absolus, les principaux bénéficiaires entre 2020 et 2023 ont été l’Égypte et le Maroc, avec plus de 10 milliards de dollars. La majorité des transferts de fonds vers les pays de la région MENA et des Balkans occidentaux proviennent de l’UE, bien que le Golfe soit également une source essentielle.
L’accès au financement reste une contrainte pour les individus dans toute la région, l’UE conservant les niveaux les plus élevés. Dans les pays de la région MENA, moins de 50 % des adultes disposent d’un compte bancaire formel, tandis que les taux de possession sont nettement inférieurs chez les femmes.
Recommandations politiques :
Réformes gouvernementales visant à renforcer les marchés financiers et les institutions, à remédier à la fragmentation financière et à faciliter les flux de capitaux transfrontaliers.
Promouvoir la diversification en recourant à des instruments financiers tels que les marchés d'actions et d'obligations d'entreprises, afin de compléter les activités bancaires et de soutenir le développement du secteur privé.
Assouplir les restrictions en matière d'IDE, rationaliser les approbations et supprimer les obstacles aux opérateurs et opérations étrangers afin d'améliorer les cadres d'investissement.
Infrastructure
Le développement de l’infrastructure de connectivité se heurte à des difficultés persistantes, en particulier dans le Sud, qui freinent les performances des systèmes logistiques et affectent le potentiel commercial.
Les pays de l’UpM émettent actuellement 13,4 % des émissions mondiales liées au transport, soit 40 % de plus qu’en 1990. Des investissements plus importants dans les infrastructures de transport multimodales, telles que les trains à grande vitesse reliés aux ports pour réduire la dépendance à l’égard des infrastructures routières, permettraient de soutenir des systèmes logistiques plus performants, d’accroître les échanges commerciaux et de créer des chaînes d’approvisionnement régionales plus durables. Cette évolution est entravée par la fragmentation réglementaire, les restrictions en matière d’IDE, la complexité de la coordination, les difficultés à mobiliser des capitaux et le nombre limité de partenariats public-privé.
Les échanges d’énergie entre les pays méditerranéens offrent une opportunité d’intégration plus poussée, compte tenu du potentiel de la région MENA à contribuer aux objectifs de l’UE en matière de climat. Toutefois, la production d’électricité par habitant dans ces pays, où la demande a augmenté de plus de 200 % entre 2000 et 2023, reste un défi, dans la mesure où ces derniers ne seront probablement pas en mesure d’exporter des quantités significatives d’énergies renouvelables dans un avenir immédiat. À quelques exceptions près, les pays de la région MENA ont progressé lentement dans la mise en place de nouvelles infrastructures de transport et d’énergie.
Bien que l’infrastructure numérique ait progressé, l’expansion du haut débit reste limitée dans les économies de la région MENA par rapport aux Balkans occidentaux et à l’UE, avec une moyenne de 76 abonnements mobiles et de 7,8 abonnements fixes pour 100 habitants. Le succès d’initiatives visant à améliorer la connectivité, telles que le câble sous-marin Medusa, dépend du déploiement national de l’infrastructure du réseau de communication.

Recommandations politiques :
Engagement renforcé dans les plateformes de coopération régionale afin de favoriser la confiance, la coordination et la cohérence des politiques, en alignant les normes, la planification transfrontalière et la continuité des réseaux d'infrastructure et des chaînes d'approvisionnement.
Soutenir le développement d'infrastructures d'énergie renouvelable, en particulier dans le sud de la Méditerranée, et son intégration dans les réseaux d'énergie locaux et régionaux.
Améliorer les infrastructures à large bande dans le sud de la Méditerranée afin de développer les communications à haut débit et la connectivité Nord-Sud.
Circulation des personnes
La mobilité ne cesse de croître, sous l’effet des pressions démographiques, de l’inadéquation du marché du travail et des disparités économiques.
La migration peut avoir des effets positifs sur le développement, mais les niveaux élevés de migration en provenance des Balkans occidentaux et de la région MENA ont suscité des inquiétudes quant à la fuite des cerveaux et à la perte de travailleurs clés. Dans les seuls États des Balkans occidentaux de l’UpM, un quart de la population vit à l’étranger. Le vieillissement de la population et la diminution de la main-d’oeuvre dans l’UE renforcent le rôle historique de la migration pour combler les lacunes du marché. L’Union a mis en place plusieurs accords, dont les partenariats de talents qui facilitent l’alignement du développement des compétences étrangères sur les besoins du marché intérieur, afin de soutenir la migration de la main-d’oeuvre.
La migration intra-UpM a augmenté de 6 % entre 2021 et 2024, dépassant les niveaux prépandémiques. La région accueille désormais plus de 34 millions de migrants intra-UpM, contre 19 millions en 1990. La majeure partie de cette migration peut être attribuée à l’UE, mais le nombre de migrants en provenance de la région MENA et des Balkans occidentaux est en hausse depuis 2021. En 2022, 1,39 million de nouveaux migrants intra-UE ont été enregistrés, soit 63 % de l’ensemble des flux intra-UpM. Cette année-là, les principaux pays d’origine des migrants étaient la Roumanie, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne.
Les défis structurels tels que le chômage élevé chez les jeunes et l’inadéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail sont un problème persistant dans les pays de la région MENA et des Balkans occidentaux. Les enquêtes indiquent un vif intérêt pour la migration : en moyenne, 35 à 40 % des personnes interrogées envisagent de migrer, un taux encore plus élevé en Tunisie (46 %), en Albanie (44 %), en Jordanie (42 %) et au Monténégro (42 %). Les principaux pays de destination dans l’UE sont la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Le Golfe est également une destination privilégiée pour les migrants de la région MENA, notamment en provenance d’Égypte, dont le nombre a triplé entre 2000 et 2024 pour atteindre 3,9 millions.
En 2023, plus de 274 800 migrants irréguliers ont atteint l’Europe en traversant la Méditerranée et l’océan Atlantique. Les données suggèrent une augmentation de 35 % des arrivées irrégulières en 2023 par rapport à l’année précédente, soit les niveaux les plus élevés depuis 2016. Le changement climatique a également provoqué 305 000 nouveaux déplacements au Moyen-Orient et en Afrique en 2022, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente. Plus récemment, des tremblements de terre en Turquie, en Syrie et au Maroc en 2023 et des inondations en Espagne en 2024 ont entraîné une augmentation des déplacements internes.
Bien que le tourisme continue de contribuer de manière significative au PIB, en particulier dans les pays non-membres de l’UE, l’instabilité régionale a réduit son impact économique, notamment au Liban, en Jordanie et en Égypte. Le tourisme a retrouvé ou dépassé les niveaux antérieurs à la pandémie dans plusieurs pays, mais il suscite des inquiétudes quant aux pressions exercées sur les communautés locales et l’environnement. L’emploi dans le secteur, qui représente environ 15 % dans l’ensemble de la région, est resté stable ces dernières années.
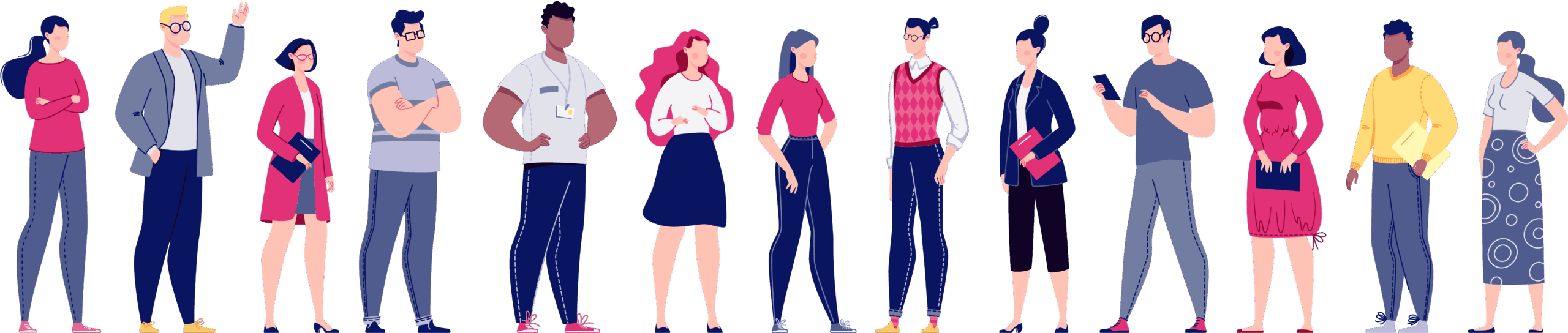
Recommandations politiques :
Améliorer la gestion des migrations de main-d'oeuvre en surveillant les flux et en donnant la priorité aux accords qui soutiennent le développement des compétences et répondent aux besoins des pays d'origine et de destination.
Promouvoir des pratiques touristiques durables afin d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles, d'atténuer les impacts environnementaux et d'équilibrer la croissance avec la durabilité à long terme.
Enseignement supérieur et recherche
L’enseignement supérieur et la recherche jouent un rôle croissant dans l’intégration et la coopération régionales, mais leur développement demeure très inégal
Alors que l’UE dispose de cadres éducatifs solides qui soutiennent la coopération et la mobilité transfrontalières ainsi que des normes harmonisées, les systèmes des pays de la région MENA ne sont intégrés ni avec l’Europe ni entre eux. Les schémas de mobilité actuels reflètent les inégalités en matière d’investissement, d’infrastructure et de capacité institutionnelle et sont largement asymétriques, dominés par les flux sortants du Sud et façonnés par des programmes de l’UE tels qu’Erasmus+. En 2022, environ 65 % de tous les étudiants en mobilité des pays de l’UpM sont restés au sein de l’UpM, principalement dans les pays de l’UE (60 %).
Les pays de l’UpM de la région MENA et des Balkans occidentaux investissent généralement moins dans l’enseignement supérieur que la moyenne de l’UE, ce qui peut affecter la compétitivité et les efforts d’intégration. En 2023, Israël a investi 6,35 % de son PIB dans la recherche et le développement (R&D), soit nettement plus que les autres pays de l’UpM. La même année, les dépenses médianes de l’UE en matière de R&D s’élevaient à 1,58 % de son PIB, bien au-dessus des 0,68 % de la région MENA, des 0,66 % de l’Afrique du Nord, des 0,57 % du Levant et des 0,29 % des Balkans occidentaux.
Des écarts entre les genres subsistent. Les hommes, par exemple, sont souvent plus nombreux que les femmes dans les postes de recherche. Dans les pays de l’UpM disposant de données, environ 48 % des étudiants mobiles de l’enseignement supérieur sont des femmes, un chiffre qui tombe à 40 % en Afrique du Nord. En revanche, en 2022, les femmes représentaient 63 % des étudiants en mobilité et 57 % du personnel dans le cadre des programmes Erasmus+.

Recommandations politiques :
Renforcer la capacité de coopération régionale en augmentant le financement public de l'enseignement supérieur et de la recherche, en particulier dans les pays du sud de la Méditerranée. Mettre en place des incitations pour encourager les chercheurs, les universités et les entreprises à participer aux programmes de financement internationaux.
Promouvoir les opportunités de mobilité en matière d'éducation et de recherche, ainsi que les échanges virtuels et la mobilité de courte durée. La mise en oeuvre de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications dans l'enseignement supérieur contribuera à améliorer la reconnaissance des diplômes et le partage d'informations.
Contexte politique
En janvier 2017, les ministres des Affaires étrangères de l’UpM ont adopté la « Feuille de route pour l’action de l’UpM » visant à renforcer le rôle de l’UpM dans la promotion d’une coopération et d’une intégration régionales accrues en Méditerranée. La Feuille de route a identifié la nécessité d’un rapport d’étape sur l’intégration régionale afin de suivre les tendances, d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps et d’éclairer l’élaboration des politiques.
Le rapport d’étape 2021 sur l’intégration régionale dans l’Union pour la Méditerranée a été préparé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec le soutien financier de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
Share this


